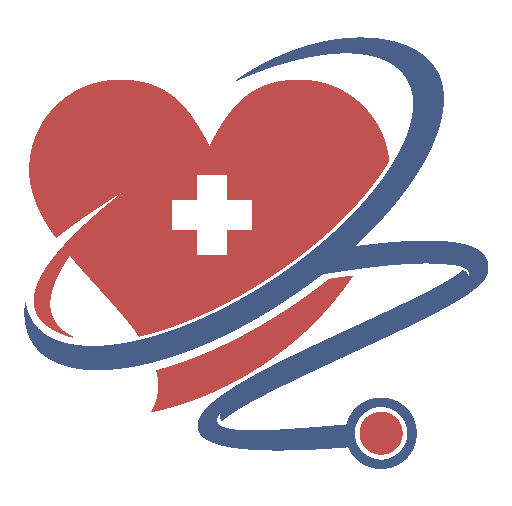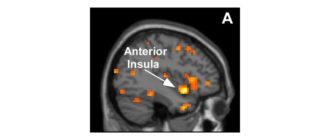Pendant des siècles, nous avons rêvé de l’existence de sirènes et de mermen, ces êtres mythiques capables de respirer sous l’eau. Et si ces créatures n’étaient pas que des légendes, mais des personnes bien réelles? Bien qu’ils n’aient pas développé de branchies, leurs corps semblent s’être adaptés à leurs conditions de vie aquatiques.

Récemment, des vidéos et des articles mettant en avant des individus qui ne portent pas de queues de poisson, mais qui vivent en se faisant passer pour des gens de mer, ont pris d’assaut Internet.
Ces personnes travaillent souvent comme artistes de la mer ou comme défenseurs de l’environnement, œuvrant pour la préservation des écosystèmes marins.
Ils sont également, plus souvent qu’autrement, des plongeurs professionnels qui connaissent les défis liés à leur passion de l’immersion sous-marine, notamment la capacité de retenir leur souffle le plus longtemps possible.
Retenir sa respiration peut s’avérer risqué, car cela entraîne un manque d’oxygène, élément crucial pour nourrir nos organes et maintenir notre vitalité.
En général, l’être humain ne peut pas retenir sa respiration plus de quelques secondes, bien que les apnéistes professionnels, après des années de pratique, puissent le faire pendant environ 3 minutes.
À travers le monde, de petites communautés vivent de l’apnée depuis des générations. Au Japon, par exemple, les plongeuses Ama, qui recherchent des huîtres perlières et d’autres fruits de mer, illustrent cette tradition en voie de disparition. Cependant, dans certaines îles d’Asie du Sud-Est, notamment parmi le peuple Bajau, des nomades de la mer continuent de vivre de leur mode de vie apnéiste, essentiel à leur subsistance quotidienne.
Le peuple Bajau plonge quotidiennement à des profondeurs impressionnantes, souvent au-delà de 70 mètres, pour chasser poissons, poulpes et concombres de mer, passant 60% de leur temps de travail immergés.
Comment ces populations ont-elles réussi à perdurer dans cette quête au fil des générations? Leur pratique de l’apnée a-t-elle modifié leur physiologie?
Melissa Ilardo, ancienne doctorante à l’Université de Copenhague et actuellement chercheuse postdoctorale à l’Université de l’Utah, a été captivée par le mode de vie des Bajau et a formulé une hypothèse intrigante.
Elle a suggéré que les corps des Bajau auraient pu évoluer pour s’adapter à leurs besoins spécifiques en apnée.
«La chose la plus proche de la Bajau – loutres de mer»
Les évolutions corporelles adaptatives chez les humains vivant dans des conditions particulières ne sont pas une nouveauté. Par exemple, une étude de 2014 a démontré que les Tibétains se sont adaptés à l’altitude grâce à une mutation génétique spécifique.
Cependant, Ilardo a envisagé les adaptations potentielles des Bajau sous un angle différent. Elle a pensé aux mammifères plongeurs tels que les phoques et les loutres, qui possèdent des rates plus volumineuses, leur permettant de stocker davantage de globules rouges que d’autres mammifères.
En contractant leur rate, ces animaux augmentent leur nombre de globules rouges lorsqu’ils plongent, ce qui améliore leur oxygénation sanguine.
Cette comparaison entre les Bajau et les loutres n’est pas fortuite.
«Les loutres de mer sont les plus proches des Bajau en termes de temps passé sous l’eau, passant également environ 60% de leur temps immergées», souligne Ilardo.
« C’est vraiment impressionnant, même comparé à d’autres plongeurs, qu’ils soient professionnels ou traditionnels », ajoute-t-elle. « Ils passent un temps exceptionnellement long sous l’eau par rapport à leur temps de récupération. »
Les nomades de la mer ont des rates plus grandes
Pour valider sa théorie, Ilardo s’est rendue en Indonésie en 2015, où elle a collaboré avec une communauté de Bajau désireuse d’en apprendre davantage sur leurs propres capacités et leur corps.
Au cours de deux expéditions, elle a utilisé un échographe portatif pour mesurer la taille de la rate de 59 individus Bajau, en la comparant à celle de 34 personnes d’un village voisin ne pratiquant pas l’apnée.
Les résultats, publiés récemment, montrent que les Bajau possèdent des rates d’environ 50% plus grandes que celles de leurs voisins sédentaires.
Aucune différence n’a été observée entre les individus apnéistes et ceux qui ne pratiquent pas cette activité au sein de la communauté Bajau.
Cela pourrait signifier que ces plongeurs augmentent leur nombre de globules rouges d’environ 10% en plongée par rapport à ceux ayant des rates de taille normale.
« Bien qu’il soit préjudiciable d’avoir des niveaux élevés de globules rouges de manière constante, cela s’avère bénéfique lors des plongées », précise Rasmus Nielsen, co-auteur de l’étude.
Il ajoute que les Bajau « ont développé une capacité à stocker plus de globules rouges pour les moments critiques, sans souffrir d’effets négatifs liés à une surproduction chronique. »
Gènes de Merfolk?
De plus, des échantillons de salive prélevés par Ilardo auprès des participants ont révélé que certains Bajau présentent des variantes génétiques rares dans les populations environnantes.
Un variant particulier, le gène PDE10A, code pour une enzyme qui participe à la régulation des hormones thyroïdiennes. Cette découverte a ouvert la porte à une nouvelle hypothèse que les chercheurs sont impatients d’explorer davantage.
« Nous pensons que l’expression de ce gène pourrait influencer la libération d’hormones thyroïdiennes, ce qui à son tour affecterait la taille de la rate », explique Nielsen.
Cependant, il reste prudent en affirmant, « Nous ne savons pas encore grand-chose sur la base génétique de la taille de la rate chez l’homme, rendant la validation de cette hypothèse dépendante de recherches futures. »
Nouveaux Horizons de Recherche
En 2024, des études supplémentaires sont prévues pour approfondir notre compréhension des adaptations physiologiques et génétiques des Bajau. Les implications de ces recherches pourraient révolutionner notre perception de l’évolution humaine et des capacités d’adaptation des populations face aux défis environnementaux.
De plus, la préservation de ce savoir traditionnel et des modes de vie des Bajau pourrait également jouer un rôle crucial dans la conservation des écosystèmes marins, en mettant en lumière la relation unique entre l’homme et la mer.
Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de sirènes, souvenez-vous qu’il pourrait y avoir une part de vérité dans ces histoires, ancrée dans la réalité des Bajau et de leur incroyable adaptation à la vie sous-marine.