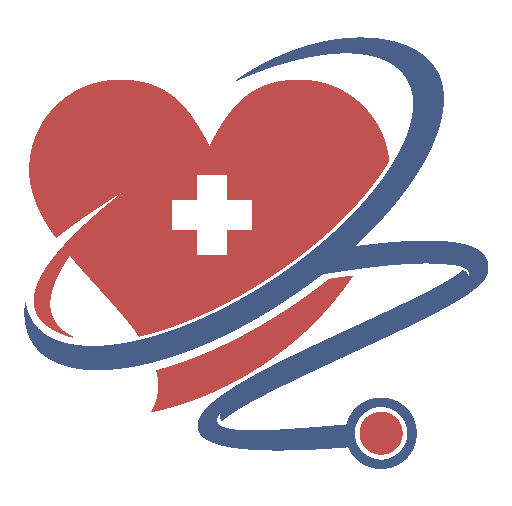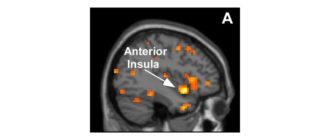Bien que ce phénomène soit souvent mal compris, il est établi que les blessures et certaines maladies peuvent entraîner la transformation des cellules cardiaques en tissu osseux. La recherche récente met en lumière les mécanismes de ce processus complexe et explore les interventions potentielles pour le freiner.
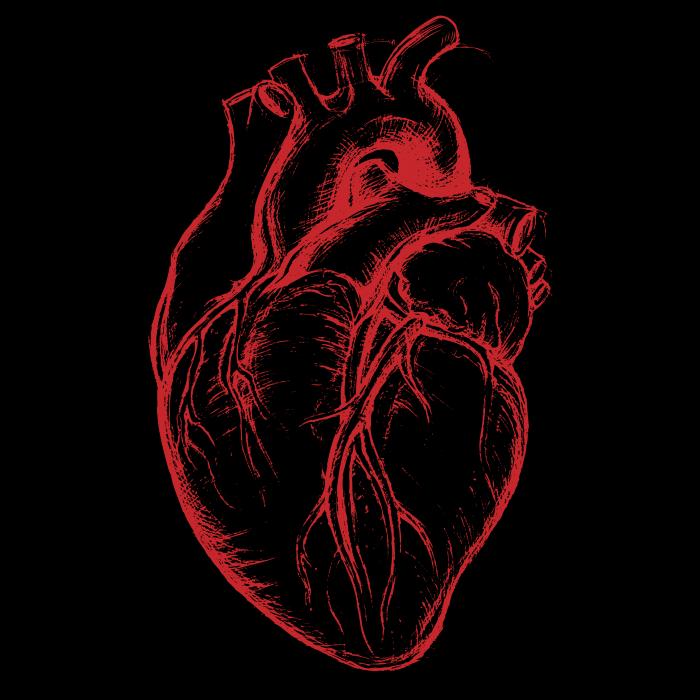
Normalement, les tissus adjacents aux os ne subissent pas de calcification. Cependant, avec l’âge, et chez les patients souffrant de diabète ou de maladies rénales, des calcifications peuvent se développer dans divers tissus.
Cette minéralisation a été observée dans des endroits tels que les vaisseaux sanguins, les reins, et bien sûr, le cœur. Lorsque cela se produit dans le cœur, cela perturbe la transmission normale des signaux électriques, ce qui peut nuire gravement à la fonction organique. À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitements capables d’inverser ou de réduire cette transformation chimique.
En effet, la calcification du muscle cardiaque représente l’une des causes sous-jacentes les plus fréquentes des blocs cardiaques, une condition où le cœur bat de manière anormalement lente.
Bien que ce phénomène de minéralisation ait été observé dans divers contextes médicaux, les mécanismes qui le sous-tendent n’ont pas été suffisamment explorés, laissant de nombreuses questions sans réponse.
Des chercheurs du Centre Eli et Edythe Broad de médecine régénérative et de recherche sur les cellules souches à l’Université de Californie à Los Angeles se sont attelés à examiner de plus près ce domaine mystérieux de la médecine.
« La calcification cardiaque a longtemps été négligée dans les études », explique Arjun Deb, auteur principal de l’étude. « Nous nous sommes demandé quelles cellules du cœur étaient responsables de cette calcification. Étant donné l’association forte entre les lésions tissulaires, la fibrose et la calcification, nous avons émis l’hypothèse que les fibroblastes cardiaques, qui jouent un rôle clé dans la cicatrisation, pourraient être impliqués dans ce processus. »
Comprendre la calcification après une blessure
Pour mieux comprendre ce phénomène de calcification au sein des tissus cardiaques, Deb et ses collaborateurs ont développé une méthode innovante pour observer les fibroblastes cardiaques à l’aide de techniques de marquage génétique. Cette étude a été réalisée sur des souris, montrant que ces cellules se transformaien en cellules osseuses ressemblant à des ostéoblastes après une blessure.
Pour approfondir leur recherche, les scientifiques ont transplanté les fibroblastes cardiaques issus de souris blessées sous la peau de souris en bonne santé, et, comme anticipé, la région a montré des signes de calcification similaire.
De plus, l’équipe a prouvé que les fibroblastes cardiaques humains pouvaient également former des dépôts de calcium en culture cellulaire, ce qui renforce l’idée que ce mécanisme est conservé chez l’homme.
Les résultats de Deb, publiés cette semaine, offrent des éclaircissements sur la manière dont les tissus peuvent se transformer en substance osseuse. La question qui se pose désormais est de savoir comment ces changements peuvent être inversés ou, au minimum, ralentis.
L’équipe a ensuite examiné l’influence d’une petite molécule, l’ENPP1, sur le processus de calcification. Cette enzyme est connue pour être surexprimée par les fibroblastes cardiaques après une blessure, ce qui en fait une cible privilégiée pour des études futures.
Injection de petites molécules réduit le processus de calcification
En injectant une série de petites molécules capables d’inhiber l’ENPP1 avant la lésion, les chercheurs ont observé une réduction de 50 % ou plus du processus de calcification. L’injection d’étidronate a particulièrement montré des résultats prometteurs : 100 % de succès, sans calcification mesurable après la lésion. L’étidronate est généralement utilisé pour traiter la maladie de Paget, qui implique un désordre dans le processus de formation osseuse.
Étant donné que cet aspect de la physiologie est encore mal exploré, cette étude représente un point de départ solide pour de futures recherches. Deb ajoute : « Nous souhaitons maintenant déterminer si ce mécanisme est commun à la calcification, indépendamment de l’étiologie, et si nos découvertes peuvent être appliquées à d’autres tissus du corps. »
D’ores et déjà, l’équipe a commencé à explorer l’utilisation d’autres petites molécules pour réduire ou prévenir la calcification dans les vaisseaux sanguins. De plus, étant donné que l’ENPP1 ne montre son efficacité que lorsqu’elle est administrée avant la blessure, des recherches sont en cours pour identifier des molécules qui pourraient fonctionner efficacement après une blessure.
Enfin, il est crucial de rester informé sur l’impact de divers facteurs, y compris l’utilisation de substances comme la marijuana, qui peuvent temporairement affaiblir le muscle cardiaque. Ces recherches pourraient ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour gérer la calcification cardiaque.